Il y a une mode, inutile, insupportable, stupide, malhonnête, consistant à assommer le spectateur innocent, dès la première image, à l’aide de la grosse massue « faits réels ». C’est ce qu’ont longtemps fait de mauvais téléfilms de deuxième partie de soirée, c’est ce que font un nombre croissant de films s’autorisant ainsi à ne pas avoir d’avis et à laisser le spectateur s’en forger un, ce qu’une coupure de presse fait pourtant au moins aussi bien qu’un long-métrage de deux heures. Les Cahiers du cinéma (n°684) - qui par ailleurs adulent Bigelow - ont trouvé à ce phénomène un joli nom : le syndrome Natasha Kampusch. Cette fois, c’est Kathryn Bigelow qui se livre au petit jeu du je-ne-suis-pas-là-pour-juger-moi-je-fais-juste-du-cinéma-pas-de-la-politique, avec Zero Dark Thirty.
Le scénario, qui relate la traque de Ben Laden par la CIA et plus particulièrement par une espionne implacable et inoxydable – campée par Jessica Chastain –, se cache donc derrière l’argument de la véracité, du factuel. Il montre patte blanche à l’aide d’un panneau : « ce qui suit est basé sur des témoignages de première main », revendiquant ainsi une objectivité qu’on sait pourtant tout à fait illusoire : des faits, certes, mais jamais tous les faits, jamais depuis tous les points de vue, et comment pourrait-il en être autrement ?
Le scénario, qui relate la traque de Ben Laden par la CIA et plus particulièrement par une espionne implacable et inoxydable – campée par Jessica Chastain –, se cache donc derrière l’argument de la véracité, du factuel. Il montre patte blanche à l’aide d’un panneau : « ce qui suit est basé sur des témoignages de première main », revendiquant ainsi une objectivité qu’on sait pourtant tout à fait illusoire : des faits, certes, mais jamais tous les faits, jamais depuis tous les points de vue, et comment pourrait-il en être autrement ?
La première scène du film est emblématique du grand écart entre le talent de réalisatrice de Bigelow et son refus de penser le problème au-delà des faits-rien-que-les-faits. D’un côté, il y a la belle idée de ne pas utiliser les images cent fois ressassées du 11 septembre 2001 mais, sur fond noir, de passer des extraits de communications téléphoniques des victimes des attentats du World Trade Center avec leurs proches et les secours. C’est fort, c’est bien vu. De l’autre, à ces milliers de victimes innocentes dont ne cessent de parler les tortionnaires des prisons secrètes de la CIA pour justifier leurs actes, n’aurait-on pas pu opposer les victimes afghanes de bombardements, pour ne retenir qu’un argument certes éculé mais qui aurait déjà ajouté un brin de complexité au discours binaire du scénario ?
Dans le même registre, pendant un bon premier quart du film, la torture infligée aux prisonniers afghans est montrée, mais rien de plus. Autant de scènes éprouvantes pour le spectateur mais dont on se demande quel but elles poursuivent. Pourquoi m’éprouver, pourquoi me mettre face à ces atrocités dont s’est rendue coupable, dans la plus totale impunité, la plus grande démocratie du Monde ? Pour les justifier ? Pour les condamner ? Non, pour m’asséner des faits, toujours des faits, pour me dire : ça s’est passé comme ça et pas autrement.
Reste, il faut bien l’admettre, le savoir-faire de Bigelow, qui donne lieu à quelques scènes mémorables, comme l’assaut final, et offre une description édifiante de ce monde peuplé de tueurs froids et déterminés comme des anges vengeurs, qui atteignent en avion militaire ou en voiture blindée des non-lieux – ambassades-bunkers, prisons secrètes hors-sol, bases militaires perdues dans le désert – où ils semblent condamnés à reproduire les mêmes gestes à l’infini. Des hétérotopies constituant un réseau quasi-invisible et radicalement coupé du reste du monde, dont on se demande si la structure même ne le rend pas étanche à toute forme de pensée un tant soit peu contradictoire.
Mais que pense Bigelow de ce qu’elle filme ? Manifestement rien. Dommage, on en restera donc au niveau de la discussion de comptoir.
J’me comprends…
La bande-annonce quand même :
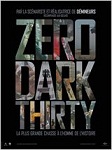
Commentaires
Enregistrer un commentaire